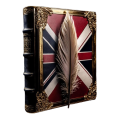Alors qu’elles ne contribuent qu’à hauteur de 0,03 % aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, les îles subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique qui affectent la pêche, l’alimentation et le tourisme ; et l’Indianocéanie est la deuxième région du monde la plus exposée aux catastrophes naturelles.
Depuis la COP21, les questions climatiques occupent largement l’Agenda 2030 du développement durable. Comment analysez-vous l’impact du changement climatique sur les îles de la COI ? D’une manière générale, les îles sont les premières victimes des dérèglements climatiques. Et pour[1]tant, elles ne contribuent qu’à hauteur de 0,03 % aux émissions mondiales de gaz à effet de serre ! Il y a là comme une forme d’injustice. La COI a forte[1]ment plaidé dans les fora internationaux pour une reconnaissance de leur spécificité, de leur vulnérabilité intrinsèque aux effets du changement climatique et donc pour un traitement différencié de la part de la communauté internationale dans l’octroi de l’aide publique. C’est ce message qui était au cœur de la Conférence des Nations unies pour les Petits États insulaires en développement de Samoa en 2014. Et preuve de la justesse de notre plaidoyer, l’Union européenne a, dans une déclaration conjointe avec la COI en marge de la COP21 en 2015, reconnu la nécessité d’un traitement différencié pour les îles. Quels sont les effets ressentis dans les îles ? Nos populations vivent concrètement, au quotidien, les effets du changement climatique. Les coraux blanchissent, ce qui a des conséquences sur la vie marine et donc sur la pêche, l’alimentation ou en[1]core le tourisme. Les plages s’érodent rapidement et le niveau de la mer tend à monter. Les risques de catastrophes naturelles s’intensifient. Kenneth, cyclone qui a durement frappé les Comores les 24 et 25 avril 2019 avec des rafales de l’ordre de 200 km/h, témoigne des menaces qui pèsent sur notre région. Pire, ce sont des cyclones tropicaux très intenses qui ont touché des zones généralement épargnées comme les Comores en avril ou l’île de Farquhar aux Seychelles avec Fantala en 2016.
Comment la COI s’engage-t-elle pour mettre en place des programmes adaptés ? Avec quels partenaires ?
À la COI, nous sommes conscients de la vulnérabilité de nos territoires et de nos populations. Nos programmes visent d’abord à améliorer la connaissance et la compréhension des risques climatiques dans nos îles puis à renforcer la résilience, les capacités nationales de prévention et de gestion des crises ou encore les techniques de prévisions saisonnières. Je tiens ici à dire que les partenaires au développement sont très à l’écoute sur ces sujets. La COI a ainsi pu compter sur l’appui de l’AFD, de l’Union européenne, de la Banque mondiale, du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes, de l’Organisation météorologique mondiale ou encore de la plateforme régionale d’intervention de la Croix-Rouge basée à La Réunion et, nous l’espérons, le Fonds vert pour le climat dans un proche avenir. Les actions conduites et à conduire sont nombreuses car c’est une approche globale des effets du changement climatique qu’il convient d’adopter pour mettre en place des mesures d’atténuation et d’adaptation. Pour ma part, il me semble que nos capacités de surveillance des territoires, avec le concours des technologies spatiales, comme nos capacités de planification des risques sont au cœur de la réponse à apporter. Il faut investir dans la prévention des risques, c’est essentiel surtout lorsque l’on sait qu’un dollar investi dans la prévention per[1]met d’économiser quatre dollars dans une situation post-catastrophe. La question est d’autant plus centrale dans nos îles aux moyens limités. Les coûts de reconstruction sont souvent élevés. Cette année, l’île mauricienne de Rodrigues a été frappée par deux fois en l’espace d’un mois par des cyclones. Il faut du temps pour se relever et, surtout, il est essentiel de rebâtir de manière innovante et en phase avec les risques pour limiter les risques de catastrophes dans le futur.
Quelles sont les perspectives et quels sont vos besoins dans ce domaine ?
La COI a développé un plan régional d’adaptation aux effets du changement climatique et de réduction des risques de catastrophes. Ce plan a été élaboré sur la base des études conduites par différents projets que nous avons mis en œuvre et qui ont permis, entre autres, de dresser les profils de risque pour chacun de nos pays. Ces profils identifient les principaux risques pour chaque île et constituent donc un cadre de référence pour la prévention et la gestion des risques. La COI travaille actuellement sur des projets de renforcement des capacités des services nationaux de météorologie afin d’affiner les prévisions et de mieux informer les institutions publiques, les opérateurs économiques et les citoyens sur les événements météo. Nous envisageons aussi de travailler sur des projets d’adaptation qui auront une composante en aménagement du territoire. À cela s’ajoutent des projets d’atténuation comme pour les énergies renouvelables ou encore des projets d’adaptation en faveur d’une gestion responsable des écosystèmes qui constituent des barrières naturelles contre les phénomènes naturels intenses.